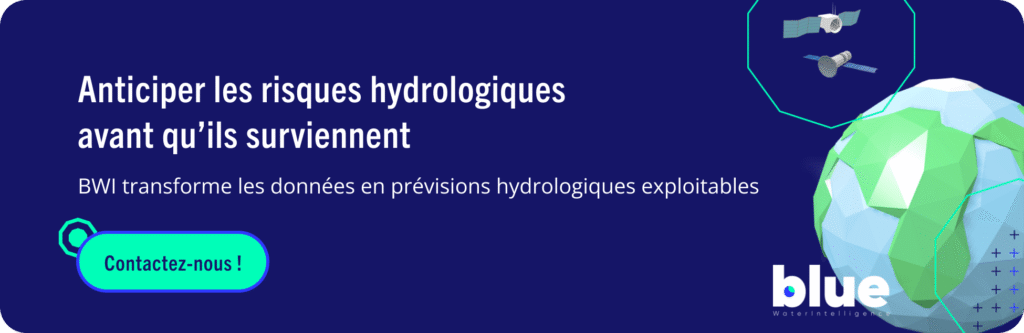Ce blog post, qui se veut un résumé du rapport d’information de l’Assemblée nationale du 12 novembre 2025 sur l’état des cours d’eau, met en avant les enjeux liés à la définition, à la quantification et à la cartographie des cours d’eau, et en extrait les conclusions et recommandations opérationnelles.
La gestion durable des ressources en eau dépend fondamentalement d’une connaissance précise et partagée des cours d’eau. Or, le rapport récent de l’Assemblée nationale (publié le 12 novembre 2025 par la mission d’information sur l’état des cours d’eau, présenté par Madame Julie Ozenne et par Monsieur Freddy Sertin, députés rapporteurs) sur l’état des cours d’eau met en lumière une difficulté majeure pour la gestion quantitative durable des ressources hydrologiques françaises : l’absence d’un référentiel clair et harmonisé de la quantité et des caractéristiques des cours d’eau en France.
Nota Bene : BWI s’est concentrée sur les volets quantitatifs du rapport, mais ledit rapport parlementaire présente des avis fort éclairés sur les enjeux de qualité des eaux. Aussi, sur ces sujets comme sur l’approfondissement des enjeux synthétisés ici, nous vous invitons à consulter le rapport en question car ce post se veut essentiellement un résumé.
Le premier constat du rapport est que la définition juridique des cours d’eau reste floue et variable selon les territoires, ce qui influe directement sur leur comptabilisation officielle. Cette imprécision repose sur des critères hydrologiques, géographiques et administratifs qui ne sont pas uniformisés. Par exemple, la frontière entre un simple ruissellement, un fossé ou un cours d’eau est sujette à interprétation : la réglementation varie d’un département à l’autre, ce qui rend difficile l’élaboration d’un inventaire exhaustif et cohérent.
Cette incertitude entraîne une importante variabilité dans la cartographie des cours d’eau, qui sert pourtant de base à toutes les politiques publiques, de la gestion des crues à la protection de la biodiversité. La fragmentation des compétences et l’absence de référentiel unifié alimentent la méconnaissance quantitative des réseaux hydrographiques.
L’état des lieux cartographique montre une forte disparité territoriale dans la prise en compte des cours d’eau. Certains bassins versants bénéficient d’une cartographie fine et dynamique, tandis que d’autres, notamment dans des zones rurales ou outre-mer, souffrent de données lacunaires voire absentes. Cette hétérogénéité génère des difficultés pour le suivi de l’état écologique et la mise en œuvre des politiques de restauration.
Le rapport souligne par ailleurs que la cartographie doit intégrer des aspects dynamiques, comme les variations saisonnières des écoulements et les modifications liées aux événements extrêmes (inondations, sécheresses). L’approche spatialisée et temporelle est donc essentielle pour appréhender la réalité quantitative des cours d’eau.
La connaissance imparfaite de la quantité et de la répartition des cours d’eau a des conséquences directes sur :
Le rapport formule de nombreuses recommandations concrètes, dont cinq ont semblé essentielles dans la lecture du rapport qu’a faite BWI :
1. Uniformiser la définition juridique et technique des cours d’eau : développer un cadre national clair, appuyé sur des critères hydrologiques robustes, pour une meilleure cohérence des inventaires et registres hydrographiques.
2. Harmoniser et fédérer les référentiels cartographiques en intégrant des données de télédétection, des mesures in situ et des modèles hydrologiques, pour une vision complète et partagée des réseaux hydrographiques sur tout le territoire.
3. Produire des cartographies dynamiques prenant en compte la saisonnalité des cours d’eau et les impacts des événements extrêmes, afin de mieux anticiper les changements et les besoins de gestion.
4. Renforcer la coopération entre acteurs locaux et nationaux pour garantir une gouvernance intégrée, alimentée par des données quantitatives précises, quelles que soient les zones géographiques concernées.
5. Intégrer les nouvelles contraintes climatiques dans les plans de gestion, en particulier pour les zones sensibles aux variations hydrologiques, afin d’adapter les stratégies de restauration et d’utilisation de la ressource.
***
Le défi de la quantification des cours d’eau est crucial pour orienter efficacement les politiques de l’eau et de l’environnement à l’échelle nationale. La mise en place d’un cadre partagé et dynamique constituera une avancée stratégique pour la gestion durable de cette ressource vitale, en garantissant des données solides et exploitables pour toutes les parties prenantes.
En définitive, cette analyse technique, politique et juridique met en lumière les besoins prioritaires en termes de données et cartographie, indispensables pour répondre aux exigences réglementaires et environnementales actuelles et futures.