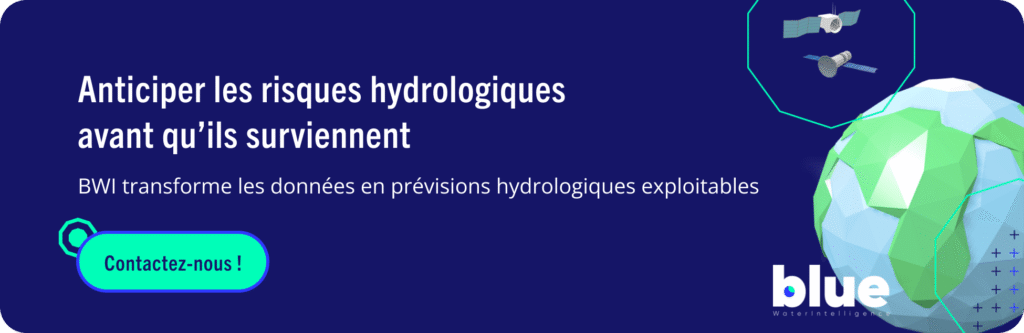Les rivières transfrontalières sont bien plus que des cours d’eau : elles sont des vecteurs de pouvoir, des sources de conflits, mais aussi d’opportunités de coopération pacifique entre États. Cet article explore, à travers anecdotes et exemples concrets, les principaux défis et succès de la diplomatie des eaux partagées, révélant l’importance cruciale de l’hydrodiplomatie dans un monde où la ressource en eau devient de plus en plus stratégique.
Les rivières, au-delà de leur rôle écologique et économique, représentent souvent des axes géopolitiques majeurs. Étant des ressources partagées entre plusieurs États, elles sont au cœur de conflits mais aussi de coopérations essentielles. Leur gestion influence directement la sécurité alimentaire, énergétique, et même la stabilité politique régionale.
Au-delà des conflits liés à l’accès à l’eau, cette ressource est de plus en plus utilisée comme arme dans les conflits. Détruire des infrastructures hydrauliques ou détourner des ressources peut paralysier des populations civiles et déstabiliser des régions entières, ce qui est contraire au droit international mais malheureusement fréquent, notamment dans des guerres récentes comme en Ukraine.
Alors que l’eau peut être une source de conflits, elle est aussi un moteur de coopération internationale. Par exemple, le traité de l’Indus (1960) entre Inde et Pakistan donne un cadre de partage de l’eau et a empêché une guerre majeure. Le dialogue et la gestion conjointe sont essentiels, mais souvent fragiles face aux enjeux économiques et politiques très forts.
L’un des obstacles majeurs est la gestion unilatérale des ressources hydriques par certains États qui détournent ou exploitent l’eau sans consulter ou négocier avec les pays en aval. Cette attitude exacerbe les tensions, comme c’est le cas dans le bassin mésopotamien où la Turquie gère seule les eaux du Tigre et de l’Euphrate, perturbant les besoins vitaux de la Syrie et de l’Irak tout en refusant souvent la médiation internationale.
Beaucoup de bassins fluviaux transfrontaliers ne disposent pas d’accords intergouvernementaux de coopération. La Convention des Nations Unies sur les cours d’eau internationaux (1997) reste une base juridique, mais sa mise en œuvre dépend du volontarisme politique des États. L’absence de normes communes alimente souvent les conflits ou empêche une gouvernance intégrée et durable.
La diplomatie de l’eau nécessite une vision à long terme, mais les cycles électoraux courts des États riverains limitent souvent les engagements durables. Les responsables politiques doivent souvent répondre à des impératifs électoraux immédiats qui favorisent des décisions populistes, comme le remplissage brusque de barrages contestés pour des raisons électorales, créant ainsi des tensions récurrentes.
La raréfaction croissante de l’eau due au climat accentue la compétition autour des ressources limitées. La baisse des précipitations, la réduction des sources glaciaires ou la sécheresse aggravent la situation sur de nombreux fleuves, rendant encore plus difficile la gestion équitable et prévisible de l’eau partagée, comme cela a été observé dans le bassin du Rhin récemment.
Les relations entre États rives peuvent être teintées de rivalités historiques, asymétries de puissance et conflits territoriaux. Un pays en position dominante peut utiliser l’eau comme levier de pression ou d’influence, ce qui complique la négociation et alimente la défiance entre partenaires. Ces tensions liées au concept de souveraineté sur l’eau alimentent le risque d’escalade des conflits.
Ces difficultés rendent la diplomatie des eaux transfrontalières délicate, d’où l’importance de bâtir un nouvel outil qu’est l’hydro-diplomatie, associant expertise scientifique, dialogue politique et gestion intégrée pour transformer l’eau en facteur de coopération plutôt que de conflit.
Voici quelques exemples montrant la complexité de la diplomatie des rivières.
Le fleuve Parana traverse plusieurs pays d’Amérique du Sud. En 1979, Brésil, Paraguay et Argentine ont signé un accord historique mettant fin à dix ans de conflits pour exploiter conjointement ses eaux. Cet accord a permis la construction du barrage d’Itaipu, l’un des plus grands barrages hydroélectriques au monde, inauguré en 1984. Cependant, le Paraguay ressent aujourd’hui un certain mécontentement car il juge que les prix de l’électricité vendue au Brésil sont défavorables, ce qui montre les enjeux économiques persistants liés à ce fleuve.
Le Nil est l’un des cas les plus emblématiques de tension géopolitique sur une rivière. L’Égypte, fortement dépendante de l’eau du Nil, a des craintes légitimes face au barrage de la Renaissance construit par l’Éthiopie en amont. Ce projet modifie le débit du Nil Bleu et crée un climat de forte discorde entre les pays riverains. Malgré une convention de 1959 entre Égypte et Soudan, les pays situés en amont ne l’ont jamais adoptée, ce qui laisse la porte ouverte à des conflits potentiels. Une coopération mutuelle reste la seule voie pour éviter des guerres liées à cette ressource vitale.
L’eau est devenue une arme dans la guerre entre l’Ukraine et la Russie. Après l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014, l’Ukraine a bloqué les principales sources d’eau vers la péninsule, privant cette dernière d’environ 80% de son approvisionnement. En réponse, la Russie a détruit en 2024 une digue pour rétablir l’irrigation, montrant comment le contrôle de l’eau peut être un levier stratégique dans les conflits modernes.
Depuis 2010, plus de 800 conflits liés à l’accès ou au contrôle de l’eau ont été recensés. L’un des cas récents implique un violent affrontement entre le Tajikistan et le Kirghizistan pour le contrôle d’un canal sur la rivière Isfara. Ce conflit a fait plusieurs morts et blessés en raison de la rivalité autour de l’accès à une ressource rare dans cette région fortement dépendante de l’eau pour l’agriculture.
Ces deux fleuves prennent leur source en Turquie pour parcourir la Syrie et l’Irak, alimentant des tensions majeures. La Turquie, en position stratégique en amont, refuse de négocier certaines conventions sur le partage de l’eau, suscitant des conflits intermittents. En 1991, la restriction du débit de l’Euphrate a été un élément déclencheur exacerbé par des tensions politiques et ethniques sous-jacentes, notamment autour de la minorité kurde.
***
La Géopolitique des rivières révèle toute la complexité de la gestion des ressources hydriques partagées. Entre intérêts nationaux, rivalités historiques, et nécessité d’un partage équitable, ces cours d’eau deviennent des enjeux stratégiques qui peuvent à la fois attiser les conflits et favoriser la coopération. Comprendre ces histoires concrètes permet de mieux appréhender les enjeux globaux de demain sur une planète où l’eau douce reste une ressource de plus en plus précieuse.